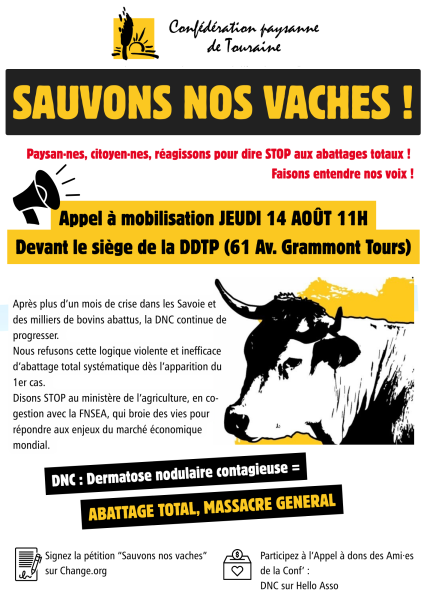Etre éleveur laitier en Touraine aujourd'hui
Une dramatique régulation... par la disparition des paysans
La crise agricole, et laitière en particulier, était bien prévisible : fin des quotas, politiques qui laissent filer la dérégulation et qui continuent de miser sur les marchés à l'exportation, etc. Les pouvoirs publics ne mettent aucun outil en place pour réguler la production de lait, seul moyen de maintenir un prix rémunérateur. Ils laissent la dérégulation aller bon train, éliminant les éleveurs qui ne peuvent pas tenir et misant sur un marché d'exportation qui tient du mirage.
A ce rythme, combien de fermes demain ? La commune du Louroux comptait par exemple treize fermes laitières en 1984, passées à sept en 2000 et il en reste trois aujourd'hui, et encore pour combien de temps ?
"Coopératives", vous avez dit "coopératives" ?
Au départ, oui, les coopératives portaient bien leur nom. Mais petit à petit, on a assisté à une déconnexion dramatique entre les paysans et les gestionnaires aux manettes des grandes coopératives. L'exemple de la coopérative de Ligueil est assez significatif : de rachat en rachat, elle est passée d'une petite coopérative locale jusqu'à devenir une grosse machine Eurial-Poitouraine, dont le directeur a été par exemple directeur de… l'Oréal. Ces gestionnaires d'entreprise sont bien loin de la réalité du terrain. En témoignent les bulletins envoyés par la coopérative à ses membres : le dernier arrivé dans la boîte à lettre début 2016 a sur cette ferme été jeté à la poubelle illico : ce bulletin se félicitait des résultats de l'année 2015 et s'enthousiasmait sur le thème « 2016 l'horizon s'élargit ». Quand on connaît le quotidien des éleveurs laitiers cette année et les perspectives à venir, il faut être bien loin du terrain pour écrire de tels éditoriaux. L'horizon s'élargit peut-être pour la coopérative, qui prévoit de fusionner avec un autre gros : Agrial pour aller à la conquête de nouveaux marchés. Il ne s'élargit pas pour la majorité des paysans laitiers, dont beaucoup redoutent de devoir cesser leur activité, produisant à perte depuis plusieurs mois déjà.
Relocaliser les productions, y compris les filières longues
La Confédération paysanne ne défend pas que les producteurs en circuits courts, avec transformation à la ferme. Les filières longues ont leur intérêt : tout le monde n'a pas envie de vendre en direct et de transformer à la ferme. Le métier d'éleveur est déjà assez prenant, avec ses astreinte quotidiennes, pour ne pas vouloir forcément se rajouter les métiers de fromagers et vendeurs. Des filières longues qui valorisent le lait en local, avec un prix rémunérateur, cela existe et c'est un objectif vers lequel tendre pour garder des exploitations nombreuses et viables sur nos territoires.
Mais reste ensuite la question de la maîtrise des décisions en filière longue : la Confédération paysanne déplore que les coopératives ne soient plus à une échelle humaine et fonctionnent comme des industriels. Statutairement, il y a bien des conseils d'administration avec des paysans, mais ils se trouvent petit à petit dépossédés des décisions, des choix techniques. Financièrement, juridiquement, c'est trop lourd, trop gros pour le paysan simple administrateur d'Eurial face aux gestionnaires. Bien souvent, le CA de paysans ne fait que valider. On tend vers une situation où le paysan sera un jour le salarié du système. Un système qui décide sans lui par exemple si le lait (son lait!) sera transformé en poudre et exporté en Chine.
Oui, des vaches laitières à l'herbe, c'est possible !
Des vaches qui pâturent, ça semble une évidence... sur l'étiquette de la bouteille de lait.
Ce n'est pas simple en réalité. La simplicité c'est de nourrir avec une ration maïs-soja : cette ration ne bougera pas de l'année, elle est parfaitement adaptée à l'industrialisation de la production.
En revanche, faire du lait avec des vaches nourries d'herbe c'est complexe : les prairies n'ont pas toujours la même composition selon les années et selon les saisons bien sûr. Il faut donc sans cesse travailler à équilibrer la ration alimentaire. Mais c'est tout là l'art (et le plaisir ?) du métier de paysan, s'adapter à son sol, au climat.
Dans les années 1990, le contrôle laitier regardait ceux qui passaient au pâturage comme des illuminés : « en Touraine pour faire du lait il faut nourrir les vaches avec du maïs » répétait-il alors. Des éleveurs ont tenté quand même, heureusement. D'ailleurs aujourd'hui le contrôle laitier a changé de posture et reconnaît que des prairies avec du trèfle permet de diminuer l'achat de protéines. Mieux vaut tard que jamais...
Un journaliste présent s'étonne : « des vaches au pré, il faut donc les rentrer deux fois par jour pour la traite ? ». Oui, et parole de paysan : « je préfère sortir dans la lumière du petit matin chercher mes vaches au pré que prendre le tracteur pour racler le lisier », « sauf quand elles se sont sauvées... quoi que, ce n'est pas pire qu'une panne de tracteur ! ».
Nourrir les vaches… et les vers de terre
Viser l'autonomie alimentaire de son troupeau, cela veut dire nourrir au maximum avec des aliments produits sur la ferme, éventuellement complétés avec des aliments des environs. Autrement dit, cesser d'importer ce soja qui participe à la déforestation de l'Amazonie et condamne la pérennité de l'agriculture des collègues paysans brésiliens.
« Pourrait-on produire du soja en Touraine ? » Ca se fait, mais moins que dans le Sud de la France et avec peu de rendements aujourd'hui, car la recherche variétale n'a pas du tout été poussée sur le soja : les accords commerciaux incitant à l'importation du soja n'ont pas encouragé une recherche publique sur le sujet
Mais d'autres solutions que le soja existent pour apporter les protéines nécessaires à un troupeau : par exemple travailler avec du tourteau de colza, ou encore semer des méteils associant céréales et légumineuses. Les fermes en démarche d'agriculture paysanne travaillent ce levier de l'autonomie alimentaire, par souci économique, environnemental et par défi technique aussi.
Sur cette ferme, le paysan développe un système agricole permettant de nourrir son troupeau, mais aussi de nourrir son sol. Il veut « remettre le sol au centre de l'activité agricole » : des sols toujours couverts, des sols biologiquement vivant pour produire de l'azote, de la matière organique, également pour stocker du carbone et diminuer l'empreinte carbone.
Aller vers un système autonome et résilient, c'est un des leviers pour continuer l'activité laitière. Pour continuer à avoir des fermes variées et nombreuses.